Bonjour,
En moyenne, les Suisses travaillent moins que leurs voisins européens
La diminution des durées contractuelles et le recours croissant au temps partiel font que la durée hebdomadaire de travail d’un Suisse se rapproche désormais de la moyenne européenne. Plus encore que les biens matériels, la nouvelle génération privilégie les loisirs et le temps libre.
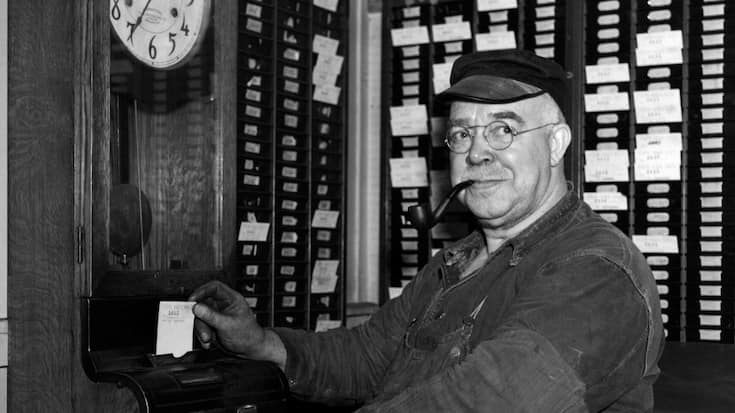
Publicité
Même dans un pays où la population a refusé de s’accorder six semaines de vacances dans les urnes, l’importance du travail dans la vie des citoyens tend à s’éroder. En 2024, être employé à taux plein en Suisse signifiait passer 40 h 04 sur son lieu de travail, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). C’est 50 minutes de moins qu’en 2019. C’est aussi presque 5 à 10 heures de moins que la limite légale, toujours fixée à 45 heures par semaine pour les emplois dans l’industrie et les services, et même à 50 heures dans l’agriculture et les soins médicaux.
Les Suisses restent en tête du classement européen pour la durée hebdomadaire la plus longue à plein temps, mais «le temps de travail effectif suit une tendance baissière depuis plusieurs décennies déjà, constate Cédric Tille, professeur d’économie au Geneva Graduate Institute. C’est une évolution lente mais continue.» Une évolution rendue possible par une hausse très prononcée de la productivité, surtout dans l’industrie. «Dans le secteur secondaire, on peut produire avec moins de main-d’œuvre. La productivité augmente davantage que dans les services. Mécaniquement, la population s’oriente alors vers les services et les emplois se tertiarisent massivement. On observe cette tendance dans tous les pays développés.» L’industrie chimique et pharmaceutique joue un rôle prépondérant dans la hausse de la productivité de l’économie suisse, et sur les salaires. Ces gains de productivité ont permis aux entreprises d’augmenter leur rentabilité. En période de tension sur le marché du travail, certaines choisissent de valoriser ces gains en offrant des horaires de plus en plus souples.
En effet, l’économie a toujours besoin d’une force de travail abondante. La pénurie de main-d’œuvre de 2022 et 2023 s’est partiellement résorbée en 2024, mais, à moyen terme, la demande des employeurs surpassera largement l’offre du marché du travail. L’économie suisse pourrait faire face à un manque de 400 000 travailleurs d’ici à 2035, selon une étude de la Banque nationale suisse parue en avril 2025. «Dans ce contexte, beaucoup d’entreprises cherchent à soigner leur attractivité. C’est notamment le cas dans les industries de pointe. La flexibilisation du temps de travail constitue un bon argument de recrutement», confirme Nicky Le Feuvre, professeure en sociologie du travail à l’Université de Lausanne.
Diminution choisie, non subie
L’augmentation continue de la productivité, et des salaires réels ces dernières décennies, constitue également un facteur décisif sur le plan macroéconomique. La réduction de la durée de travail générale ayant évolué en parallèle d’une hausse du produit intérieur brut, la productivité de l’économie suisse s’est globalement améliorée, ouvrant la voie à une réduction du temps de travail sans renoncement matériel majeur.Pour Cédric Tille, cette évolution n’a rien d’inquiétant: «Il s’agit d’une baisse d’activité choisie et non subie.» Selon le professeur, le phénomène s’explique notamment par l’évolution de la consommation: «Plus la productivité augmente, plus nous avons les moyens de consommer. Aujourd’hui, les salariés se tournent volontiers vers des loisirs plutôt que vers une nouvelle voiture.» Cette «consommation temporelle» n’échappe pas à la logique économique. Les loisirs, les activités culturelles ou sportives génèrent eux aussi de la valeur. «Il s’agit donc d’une forme de consommation économique mais non marchande.»
Publicité
En somme, cette réorganisation du temps productif est sans doute le fruit d’une aspiration collective à garder davantage de temps pour soi, mais qui se matérialise sous forme d’une évolution lente et progressive, et non disruptive. L’emploi conserve une place centrale dans la société suisse, mais il n’est plus l’unique repère autour duquel s’articule la vie des citoyens. «Si les gens choisissent de consommer des loisirs, où est le problème? Ce n’est pas une perte pour l’économie, mais un signe que les priorités ont changé», observe Cédric Tille. Pour l’économiste, cette baisse de la durée de travail ne constitue pas non plus une menace pour la compétitivité du pays. «La Suisse est une économie largement exportatrice. Si ses habitants consomment un peu moins de biens et de services, cela n’a qu’un effet marginal sur la croissance. La baisse du temps de travail entraîne certes une baisse des cotisations pour les assurances sociales, mais les bénéfices sociaux pourraient être notables: moins de surmenage, moins de burn-out, et peut-être une baisse des coûts liés à la santé.»
Le rôle du temps partiel féminin
Mais les Suisses sont aussi champions des taux d’activité réduits. Selon l’OFS, la part des employés à temps partiel a augmenté de plus de 13 points depuis 1991, pour atteindre près de 39% des personnes en emploi en 2024. Conséquence: les Suisses – tous taux d’activité confondus – travaillent en moyenne 35 heures et 17 minutes par semaine, soit 15 minutes de moins que la moyenne européenne. En somme, les contrats à plein temps sont plus exigeants que dans les pays voisins, mais la population opte aussi plus souvent pour des taux d’activité réduits. En outre, ce mode de travail est surtout adopté par les femmes, et plus encore par les mères, ce qui atteste de son lien toujours très marqué avec le modèle familial traditionnel. En 2024, seulement 41% des femmes travaillaient à plein temps, contre 79% chez les hommes. «Certes, le recours au temps partiel progresse aussi chez les hommes, mais cette diminution de leur taux d’activité intervient surtout en fin de carrière», explique Nicky Le Feuvre. Dans les secteurs bancaires ou industriels, beaucoup de cadres préfèrent aujourd’hui réduire leur taux à partir de 60 ans plutôt que de partir en retraite anticipée. «L’essor du travail à temps partiel chez les hommes ne s’explique pas, comme on l’entend parfois, par une participation accrue à la vie de famille.»Publicité
Les crèches hors de prix, la durée relativement courte de la journée scolaire et la fiscalité peu incitative pour le deuxième revenu créent des obstacles structurels à l’emploi des femmes, selon la chercheuse. «Dans de nombreux couples, le second salaire perd en rentabilité fiscale dès qu’il fait passer le ménage dans une tranche d’imposition plus élevée. Résultat: les femmes sont les premières à adapter leur activité, pour des raisons historiques et sociales.» Cette configuration socioéconomique se reflète même dans les offres d’emploi. «La majorité des postes à pourvoir dans les domaines professionnels majoritairement féminins, comme l’éducation et le travail social, sont proposés à temps partiel, à des taux très variables.»
40 h 04
En 2024, être employé à taux plein en Suisse signifiait passer 40 h 04 sur son lieu de travail, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). C’est 50 minutes de moins qu’en 2019.
En 2024, être employé à taux plein en Suisse signifiait passer 40 h 04 sur son lieu de travail, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). C’est 50 minutes de moins qu’en 2019.
400 000
L’économie suisse pourrait faire face à un manque de 400 000 travailleurs d’ici à 2035, selon une étude de la Banque nationale suisse.
L’économie suisse pourrait faire face à un manque de 400 000 travailleurs d’ici à 2035, selon une étude de la Banque nationale suisse.
39%
Selon l’OFS, la part des employés à temps partiel a augmenté de plus de 13 points depuis 1991, pour atteindre près de 39% des personnes en emploi en 2024.
Selon l’OFS, la part des employés à temps partiel a augmenté de plus de 13 points depuis 1991, pour atteindre près de 39% des personnes en emploi en 2024.
41%
En 2024, seulement 41% des femmes travaillaient à plein temps, contre 79% chez les hommes.
En 2024, seulement 41% des femmes travaillaient à plein temps, contre 79% chez les hommes.
A propos des auteurs
Publicité

